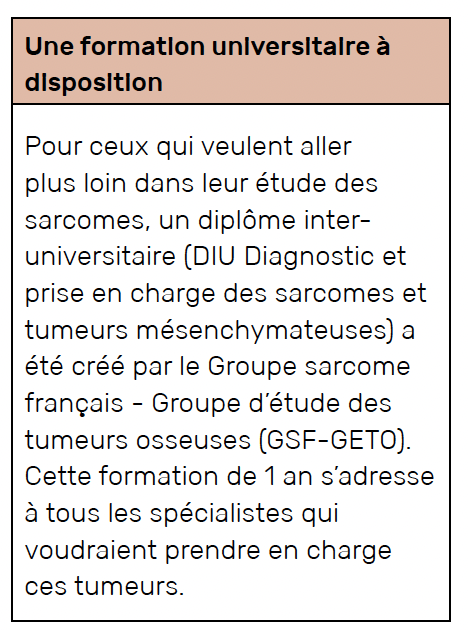Les sarcomes des tissus mous sont des cancers rares dont la qualité de la démarche diagnostique initiale conditionne le pronostic. Une prise en charge d’emblée au sein d’un centre du réseau NETSARC+ prévient le risque de perte de chance.
Résumé
Les sarcomes des tissus mous sont des cancers rares d’origine mésenchymateuse qui se développent à tous les âges de la vie. Devant toute masse inexpliquée des tissus mous, penser systématiquement aux sarcomes permet d’éviter une prise en charge inadéquate entraînant une perte de chance pour le patient. La démarche diagnostique recommandée par la société européenne d’oncologie médicale inclut une imagerie adaptée (et son analyse correcte), une biopsie coaxiale percutanée de large calibre suivant un trajet adapté, une relecture anatomopathologique et une discussion de la stratégie thérapeutique en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) spécialisée pour permettre un traitement multimodal réalisé au sein d’un centre du réseau national NETSARC+ labellisé par l’Institut national du cancer (INCa).
Abstract
Focus on soft tissue sarcomas
Soft tissue sarcomas are rare malignant tumors of mesenchymal origin that develop at all ages. In front of any unexplained soft tissue mass, thinking about sarcoma helps avoid inadequate treatment leading to poor survival. The diagnostic approach recommended by the ESMO includes appropriate imaging (and its correct analysis), a large-caliber percutaneous needle-core coaxial biopsy, a systematic anatomopathological review and a discussion of the therapeutic strategy in specialized MTD for allowing multimodal treatment carried out within a specialized center of the labeled national network of rare cancers NETSARC+.
Un cancer rare pas si rare que ça
Les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs malignes d’origine mésenchymateuse qui se développent à tous les âges de la vie dont l’incidence est estimée à 58 nouveaux cas par million d’habitants et an, représentant moins de 1 % des cancers de l’adulte et environ 15 % des cancers de l’enfant. Bien que plusieurs facteurs de risque aient été identifiés (prédisposition génétique, lymphœdème chronique, exposition aux radiations ionisantes, infections virales, exposition à des toxiques industriels), les sarcomes des tissus mous sont majoritairement sporadiques. Comme tous les cancers rares, ils génèrent deux défis : faire le diagnostic et définir la stratégie thérapeutique.
Être suspicieux devant toute masse inexpliquée des tissus mous
De par leur distribution anatomique ubiquitaire (49 % sont localisés sur un membre, 40 % sur le tronc et 11 % sur le segment tête et cou) et leur survenue tant chez l’adulte que l’enfant, les sarcomes des tissus mous sont individuellement rarement rencontrés par le même médecin généraliste/spécialiste hors centre spécialisé, avec pour conséquence directe une errance diagnostique initiale, un inconfort des équipes et une perte de chance individuelle potentielle si un traitement inadapté est envisagé. Partir du principe que toute masse inexpliquée des tissus mous est potentiellement un sarcome permet d’éviter les mauvaises décisions et d’orienter le patient vers un centre spécialisé dès la suspicion diagnostique.
Une démarche diagnostique dont la qualité conditionne le pronostic
Indépendante du site tumoral, la démarche diagnostique initiale conditionne le pronostic du membre en cas de sarcome périphérique et le pronostic vital en cas de sarcome tronculaire (pelvis, abdomen, thorax, tête, cou et racines des membres). La suspicion diagnostique doit déclencher une prise en charge diagnostique standardisée au niveau européen incluant :
• un bilan d’imagerie locorégional (scanner ou IRM) et à distance (scanner thoracique),
• une biopsie à visée diagnostique pré-thérapeutique
• et une discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) spécialisée.
L’objectif de l’imagerie n’est pas diagnostique, mais cherche à identifier l’organe d’origine de la masse, à définir sa localisation anatomique, à voir ses limites anatomiques réelles de la masse, à identifier des “zones critiques” chirurgicales (contacts avec vaisseaux, nerfs, os, peau, viscères…) et à rechercher d’éventuelles lésions à distance (pulmonaires, hépatiques, péritonéales).
D’autres examens complémentaires peuvent être demandés, mais uniquement sur la base de l’histologie obtenue par biopsie percutanée réalisée sous contrôle radiologique avec un matériel adapté (système coaxial et aiguille de large calibre), multiple (quatre prélèvements, dont deux fixés dans du formol tamponné à 4 % et deux congelés) devant toute masse inexpliquée superficielle de plus de 5 cm (la biopsie-exérèse complète sans effraction tumorale restant une alternative pour les lésions superficielles de moins de 5 cm) ou profonde ou indépendamment de sa taille chez un patient de moins de 18 ans, évitant la morbidité directement associée au geste ou à la contamination de tissus et/ou organes adjacents. La biopsie chirurgicale n’est plus recommandée dans les tumeurs des tissus mous vu le risque d’essaimage, quelle que soit sa technique. En cas de doute, la voie d’abord de la biopsie doit être discutée en RCP.
Un diagnostic anatomopathologique complexe
La classification de référence des tumeurs conjonctives est celle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) actualisée en 2020. Elle répertorie les tumeurs conjonctives selon leur ligne de différenciation, c’est-à-dire par rapport au tissu formé par la tumeur avec pour chaque type des variétés bénignes, de malignité intermédiaire et malignes.
• L’examen histologique de la coloration standard est la base de la démarche diagnostique.
• L’étude immunohistochimique cherche ensuite à confirmer le diagnostic morphologique.
• L’analyse moléculaire contribue enfin à une classification des tumeurs conjonctives de plus en plus précise.
• L’évaluation du potentiel d’agressivité d’un sarcome des tissus mous doit également inclure le grade de malignité de la Fédération nationale des centres de luttes contre le cancer (FNCLCC), prenant en compte la différenciation du sarcome, l’index mitotique et le pourcentage de nécrose.
Le diagnostic anatomopathologique doit être posé par un pathologiste spécialisé et une relecture est systématiquement recommandée lorsque le diagnostic initial est fait en dehors du réseau spécialisé NETSARC+. Ces relectures anatomopathologiques permettent une correction diagnostique dans 9 à 25 % des cas selon leur complexité.
Une offre de recours couvrant tout le territoire national
Nous avons la chance en France d’avoir le réseau NETSARC+ labellisé par l’INCa qui coordonne, via un maillage territorial de 25 centres de compétence (et leurs RCP), la définition des recommandations de prise en charge des patients atteints de sarcomes, la structuration de la filière de soins, l’organisation de l’activité de recours, la coordination de la recherche, la participation à une veille épidémiologique et la formation (expertisesarcome.org). NETSARC+ couvre également tout l’outre-mer via ses RCP en visioconférence et son centre de compétence ultramarin à la Réunion.
Une chirurgie qui peut guérir, mais qui ne s’improvise pas
La prise en charge chirurgicale repose sur la qualité de la prise en charge diagnostique dont elle est indissociable. Les sarcomes des tissus mous, transcendant par nature les limites anatomiques, posent des problèmes de compétences techniques dans le cadre de notre médecine de plus en plus sectorisée. Le principe général guidant la prise en charge chirurgicale est de réséquer la tumeur en bloc sans effraction tumorale, sans curage ganglionnaire, avec une marge circonférentielle de tissu sain. C’est dans la planification de l’épaisseur minimale de cette marge circonférentielle que réside l’expertise chirurgicale, car elle dépend aujourd’hui de plusieurs facteurs comme le type histologique, la localisation tumorale, le grade FNCLCC, la nature du type de tissu (barrière anatomique), les traitements déjà réalisés, la morbidité associée à la résection, l’état général du malade. Cette personnalisation de la prise en charge doit bien sûr aller de pair avec la capacité technique permettant sa concrétisation, impliquant la concentration de compétences en chirurgies viscérale, urologique, gynécologique, reconstructrice, thoracique, cervico-faciale, orthopédique au service de l’intervention à réaliser. Une étude française récente a démontré que cette approche chirurgicale globale était bénéfique pour le patient avec une amélioration des survies globales et sans récidive lorsque la prise en charge était réalisée au sein d’un des centres NETSARC+.
Un travail d’équipe
Bien que la chirurgie soit la pierre angulaire de la guérison des sarcomes, elle doit, dans certaines circonstances, être encadrée par un traitement périopératoire permettant de diminuer le risque de récidive.
La chimiothérapie
La chimiothérapie préopératoire n’est pas un standard dans les sarcomes des tissus mous. Elle pourrait avoir un intérêt dans les sarcomes de haut grade et/ou progressant rapidement et/ou dans certains sous-types histologiques chimio-sensibles. On rapporte fréquemment qu’elle pourrait être administrée pour faciliter une chirurgie, mais avec un taux de réponse objective, toutes histologies confondues, de 27 % en cas de polychimiothérapie et de 13 % en cas de monothérapie, c’est rarement le cas.
Plusieurs études ont essayé de démontrer le bénéfice de chimiothérapies “à la carte” sans succès, le schéma de référence restant celui à base de doxorubicine élaboré dans les années 1970.
La radiothérapie
La radiothérapie est un outil majeur pour prévenir le risque de récidive locale. La société européenne d’oncologie médicale recommande une radiothérapie en association à la chirurgie dans le traitement curatif des lésions profondes périphériques de haut grade, quelle que soit leur taille. Une radiothérapie peut être discutée en cas de lésion superficielle de plus de 5 cm, quel que soit le grade et en cas de lésion profonde de bas grades, quelle que soit la taille. Il n’y a aujourd’hui pas de consensus quant à sa réalisation préopératoire ou postopératoire, la radiothérapie réalisée avant la chirurgie ayant l’avantage de mieux centrer le traitement sur une tumeur en place, mais avec l’inconvénient d’une morbidité postopératoire accrue. La réalisation d’une radiothérapie préopératoire en cas de sarcome à haut risque de résection marginale (R1) ou d’une radiothérapie postopératoire après chirurgie marginale (R1) non réopérable parfois proposée n’est pas un standard et doit faire l’objet d’une discussion en RCP spécialisée.
Composante majeure du contrôle local de la maladie, plusieurs études ont essayé d’optimiser la radiothérapie, soit pour en améliorer l’efficacité, soit pour en diminuer la toxicité. Les pistes suivies sont nombreuses comme l’injection intra-tumorale de nanoparticules radioamplificatrices d’hafnium, la combinaison de la radiothérapie à un traitement systémique (doxorubicine, pazopanib, trabectédine…), l’hypofractionnement ou la désescalade de dose dans certains sous-types histologiques radiosensibles (liposarcome myxoïde). À l’exception de l’utilisation des nanoparticules d’hafnium validée par un essai de phase II-III randomisé, le niveau de preuve de ces stratégies prometteuses reste faible et elles doivent faire l’objet d’études complémentaires.
Une surveillance personnalisée après traitement
Les protocoles de surveillance actuels après traitement curatif d’un sarcome des tissus mous reposent sur un faible niveau de preuve. La société européenne d’oncologie médicale propose néanmoins une surveillance :
• tous les 4 mois les 2 à 3 premières années
• puis tous les 6 mois jusqu’à 5 ans,
• puis tous les ans jusqu’à 10 ans.
Il faut compléter cette proposition en intégrant la variabilité du risque de récidive (dépendant du type histologique, du grade, de la taille, du site tumoral, de la marge chirurgicale, des traitements réalisés…), mais aussi les sites préférentiels de récidive. À l’image de ce qui a été dit pour la chirurgie/chimiothérapie/radiothérapie, le suivi d’un patient après traitement curatif d’un sarcome doit être personnalisé pour permettre à la fois une détection des récidives le plus tôt possible, mais sans “rater” les plus tardives, en garantissant une compliance et en limitant l’irradiation corporelle. Une fois encore, l’apport d’une discussion en RCP spécialisée au sein de NETSARC+ peut être bénéfique pour le patient.
L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en rapport avec cet article.
Bibliographie
1. Blay JY, Honoré C, Stoeckle E et al. Surgery in reference centers improves survival of sarcoma patients: a nationwide study. Ann Oncol 2019 ; 30 : 1143-53.
2. Blay JY, Soibinet P, Penel N et al. Improved survival using specialized multidisciplinary board in sarcoma patients. Ann Oncol 2017 ; 28 : 2852-9.
3. Bonvalot S, Rutkowski PL, Thariat J et al. NBTXR3, a first-in-class radioenhancer hafnium oxide nanoparticle, plus radiotherapy versus radiotherapy alone in patients with locally advanced soft-tissue sarcoma (Act.In.Sarc): a multicentre, phase 2-3, randomised, controlled trial. Lancet Oncol 2019 ; 20 : 1148-59.
4. de Pinieux G, Karanian M, Le Loarer F et al. Nationwide incidence of sarcomas and connective tissue tumors of intermediate malignancy over four years using an expert pathology review network PLoS One 2021 ; 16 : e0246958.
5. Fletcher CDM, Bridge JA, Hogendoorn CW, Mertens F. WHO classification of tumours. Soft tissue and bone tumours. 5th edition, 2020. IARC Press Lyon ed.
6. Gatta G, Capocaccia R, Botta L et al. Burden and centralised treatment in Europe of rare tumours: results of RARECAREnet – a population-based study. Lancet Oncol 2017 ; 18 : 1022‑39.
7. Gronchi A, Miah AB, Dei Tos AP et al. Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO–EURACAN–GENTURIS Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2021 ; 32 : 1348‑65.
8. Honoré C, Méeus P, Stoeckle E, Bonvalot S. Soft tissue sarcoma in France in 2015: Epidemiology, classification and organization of clinical care. J Visc Surg 2015 ; 152 : 223-30.
9. Ray-Coquard I, Montesco MC, Coindre JM et al. Sarcoma: concordance between initial diagnosis and centralized expert review in a population-based study within three European regions. Ann Oncol 2012 ; 23 : 2442-9.
10. Trojani M, Contesso G, Coindre JM et al. Soft-tissue sarcomas of adults: study of pathological prognostic variables and definition of a histopathological grading system. Int J Cancer 1984 ; 33 : 37-42.